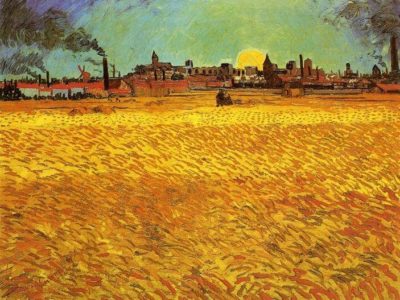Retrouvez le poème Nox de Victor Hugo extrait du recueil de poésie Les Châtiments en pdf, ebook, livre audio, vidéo, écoute, lecture libre, texte gratuit et images à télécharger ainsi qu’un résumé et une analyse.
| Auteur | Victor Hugo |
|---|---|
| Recueil | Les Châtiments |
| Genre | Poésie |
| Caractère | Poésie Satirique |
| Courant | Romantisme |
| Siècle de parution | 19ème siècle |
La vidéo
Le texte
Nox
I
C’est la date choisie au fond de ta pensée,
Prince ! il faut en finir, — cette nuit est glacée,
Viens, lève-toi ! Flairant dans l’ombre les escrocs,
Le dogue Liberté gronde et montre ses crocs ;
Quoique mis par Carlier à la chaîne, il aboie ;
N’attends pas plus longtemps ! c’est l’heure de la proie.
Vois, décembre épaissit son brouillard le plus noir ;
Comme un baron voleur qui sort de son manoir,
Surprends, brusque assaillant, l’ennemi que tu cernes.
Debout ! les régiments sont là dans les casernes,
Sac au dos, abrutis de vin et de fureur,
N’attendant qu’un bandit pour faire un empereur.
Mets ta main sur ta lampe et viens d’un pas oblique ;
Prends ton couteau, l’instant est bon ; la république,
Confiante, et sans voir tes yeux sombres briller,
Dort, avec ton serment, prince, pour oreiller.
Cavaliers, fantassins, sortez ! dehors les hordes !
Sus aux représentants ! soldats, liez de cordes
Vos généraux jetés dans la cave aux forçats !
Poussez, la crosse aux reins, l’assemblée à Mazas !
Chassez la haute-cour à coups de plat de sabre !
Changez-vous, preux de France, en brigands de Calabre !
Vous, bourgeois, regardez, vil troupeau, vil limon,
Comme un glaive rougi qu’agite un noir démon,
Le coup d’état qui sort flamboyant de la forge !
Les tribuns pour le droit luttent ; qu’on les égorge !
Routiers, condottieri, vendus, prostitués,
Frappez ! tuez Baudin ! tuez Dussoubs ! tuez !
Que fait hors des maisons ce peuple ? Qu’il s’en aille !
Soldats, mitraillez-moi toute cette canaille !
Feu ! feu ! Tu voteras ensuite, ô peuple roi !
Sabrez le droit, sabrez l’honneur, sabrez la loi !
Que sur les boulevards le sang coule en rivières !
Du vin plein les bidons ! des morts plein les civières !
Qui veut de l’eau-de-vie ? En ce temps pluvieux
Il faut boire. Soldats, fusillez-moi ce vieux !
Tuez-moi cet enfant. Qu’est-ce que cette femme ?
C’est la mère ? tuez. Que tout ce peuple infâme
Tremble, et que les pavés rougissent ses talons !
Ce Paris odieux bouge et résiste. Allons !
Qu’il sente le mépris, sombre et plein de vengeance,
Que nous, la force, avons pour lui, l’intelligence !
L’étranger respecta Paris : soyons nouveaux !
Traînons-le dans la boue aux crins de nos chevaux !
Qu’il meure ! qu’on le broie et l’écrase et l’efface !
Noirs canons, crachez-lui vos boulets à la face !
II
C’est fini ! Le silence est partout, et l’horreur.
Vive Poulmann césar et Soufflard empereur !
On fait des feux de joie avec les barricades ;
La porte Saint-Denis sous ses hautes arcades
Voit les brasiers trembler au vent et rayonner.
C’est fait, reposez-vous ; et l’on entend sonner
Dans les fourreaux le sabre et l’argent dans les poches.
De la banque aux bivouacs on vide les sacoches.
Ceux qui tuaient le mieux et qui n’ont pas bronché
Auront la croix d’honneur par-dessus le marché.
Les vainqueurs en hurlant dansent sur les décombres.
Des tas de corps saignants gisent dans les coins sombres.
Le soldat, gai, féroce, ivre, complice obscur,
Chancelle, et, de la main dont il s’appuie au mur,
Achève d’écraser quelque cervelle humaine.
On boit, on rit, on chante, on ripaille, on amène
Des vaincus qu’on fusille, hommes, femmes, enfants.
Les généraux dorés galopent triomphants,
Regardés par les morts tombés à la renverse.
Bravo ! César a pris le chemin de traverse !
Courons féliciter l’Élysée à présent.
Du sang dans les maisons, dans les ruisseaux du sang,
Partout ! Pour enjamber ces effroyables mares,
Les juges lestement retroussent leurs simarres,
Et l’église joyeuse en emporte un caillot
Tout fumant, pour servir d’écritoire à Veuillot.
Oui, c’est bien vous qu’hier, riant de vos férules,
Un caporal chassa de vos chaises curules,
Magistrats ! Maintenant que, reprenant du cœur,
Vous êtes bien certains que Mandrin est vainqueur,
Que vous ne serez pas obligés d’être intègres,
Que Mandrin dotera vos dévouements allègres,
Que c’est lui qui paîra désormais, et très bien,
Qu’il a pris le budget, que vous ne risquez rien,
Qu’il a bien étranglé la loi, qu’elle est bien morte,
Et que vous trouverez ce cadavre à sa porte,
Accourez, acclamez, et chantez hosanna !
Oubliez le soufflet qu’hier il vous donna,
Et, puisqu’il a tué vieillards, mères et filles,
Puisqu’il est dans le meurtre entré jusqu’aux chevilles,
Prosternez-vous devant l’assassin tout-puissant,
Et léchez-lui les pieds pour effacer le sang !
III
Donc cet homme s’est dit : — « Le maître des armées,
L’empereur surhumain
Devant qui, gorge au vent, pieds nus, les renommées
Volaient, clairons en main,
« Napoléon, quinze ans, régna dans les tempêtes,
Du sud à l’aquilon.
Tous les rois l’adoraient, lui, marchant sur leurs têtes,
Eux, baisant son talon ;
« Il prit, embrassant tout dans sa vaste espérance,
Madrid, Berlin, Moscou ;
Je ferai mieux, je vais enfoncer à la France
Mes ongles dans le cou !
« La France libre et fière et chantant la concorde,
Marche à son but sacré ;
Moi, je vais lui jeter par derrière une corde
Et je l’étranglerai.
« Nous nous partagerons, mon oncle et moi, l’histoire ;
Le plus intelligent,
C’est moi, certes ! il aura la fanfare de gloire,
J’aurai le sac d’argent.
« Je me sers de son nom, splendide et vain tapage,
Tombé dans mon berceau.
Le nain grimpe au géant. Je lui laisse sa page,
Mais j’en prends le verso.
« Je me cramponne à lui. C’est moi qui suis le maître.
J’ai pour sort et pour loi
De surnager sur lui dans l’histoire, ou peut-être
De l’engloutir sous moi.
« Moi, chat-huant, je prends cet aigle dans ma serre.
Moi si bas, lui si haut,
Je le tiens ! je choisis son grand anniversaire,
C’est le jour qu’il me faut.
« Ce jour-là, je serai comme un homme qui monte
Le manteau sur ses yeux ;
Nul ne se doutera que j’apporte la honte
A ce jour glorieux.
« J’irai plus aisément saisir mon ennemie
Dans mes poings meurtriers ;
La France ce jour-là sera mieux endormie
Sur son lit de lauriers. » —
Alors il vint, cassé de débauches, l’œil terne,
Furtif, les traits pâlis,
Et ce voleur de nuit alluma sa lanterne
Au soleil d’Austerlitz !
IV
Victoire ! il était temps, prince, que tu parusses !
Les filles d’opéra manquaient de princes russes ;
Les révolutions apportent de l’ennui
Aux Jeannetons d’hier, Pamélas d’aujourd’hui ;
Dans don Juan qui s’effraie un Harpagon éclate,
Un maigre filet d’or sort de sa bourse plate ;
L’argent devenait rare aux tripots ; les journaux
Faisaient le vide autour des confessionnaux ;
Le sacré-cœur, mourant de sa mort naturelle,
Maigrissait ; les protêts, tourbillonnant en grêle,
Drus et noirs, aveuglaient le portier de Magnan ;
On riait aux sermons de l’abbé Ravignan ;
Plus de pur-sang piaffant aux portes des donzelles ;
L’hydre de l’anarchie apparaissait aux belles
Sous la forme effroyable et triste d’un cheval
De fiacre les traînant pour trente sous au bal.
La désolation était sur Babylone.
Mais tu surgis, bras fort ; tu te dresses, colonne ;
Tout renaît, tout revit, tout est sauvé. Pour lors
Les figurantes vont récolter des milords,
Tous sont contents, soudards, francs viveurs, gent dévote,
Tous chantent, monseigneur l’archevêque, et Javotte.
Allons ! congratulons, triomphons, partageons !
Les vieux partis, coiffés en ailes de pigeons,
Vont s’inscrire, adorant Mandrin, chez son concierge.
Falstaff allume un punch, Tartuffe brûle un cierge.
Vers l’Élysée en joie, où sonne le tambour,
Tous se hâtent, Parieu, Montalembert, Sibour,
Rouher, cette catin, Troplong, cette servante,
Grecs, juifs, quiconque a mis sa conscience en vente,
Quiconque vole et ment cum privilegio,
L’homme du bénitier, l’homme de l’agio,
Quiconque est méprisable et désire être infâme,
Quiconque, se jugeant dans le fond de son âme,
Se sent assez forçat pour être sénateur.
Myrmidon de César admire la hauteur.
Lui, fait la roue et trône au centre de la fête.
— Eh bien, messieurs, la chose est-elle un peu bien faite ?
Qu’en pense Papavoine et qu’en dit Loyola ?
Maintenant nous ferons voter ces drôles-là ;
Partout en lettres d’or nous écrirons le chiffre. –
Gai ! tapez sur la caisse et soufflez dans le fifre ;
Braillez vos salvum fac, messeigneurs ; en avant
Des églises, abri profond du Dieu vivant,
On dressera des mâts avec des oriflammes.
Victoire ! venez voir les cadavres, mesdames.
V
Où sont-ils ? Sur les quais, dans les cours, sous les ponts,
Dans l’égout, dont Maupas fait lever les tampons,
Dans la fosse commune affreusement accrue,
Sur le trottoir, au coin des portes, dans la rue,
Pêle-mêle entassés, partout ; dans les fourgons
Que vers la nuit tombante escortent les dragons,
Convoi hideux qui vient du Champ de Mars, et passe,
Et dont Paris tremblant s’entretient à voix basse.
O vieux mont des Martyrs, hélas, garde ton nom !
Les morts, sabrés, hachés, broyés par le canon,
Dans ce champ que la tombe emplit de son mystère,
Etaient ensevelis la tête hors de terre.
Cet homme les avait lui-même ainsi placés,
Et n’avait pas eu peur de tous ces fronts glacés.
Ils étaient là, sanglants, froids, la bouche entr’ouverte,
La face vers le ciel, blêmes dans l’herbe verte,
Effroyables à voir dans leur tranquillité,
Eventrés, balafrés, le visage fouetté
Par la ronce qui tremble au vent du crépuscule ;
Tous, l’homme du faubourg qui jamais ne recule,
Le riche à la main blanche et le pauvre au bras fort,
La mère qui semblait montrer son enfant mort,
Cheveux blancs, tête blonde, au milieu des squelettes,
La belle jeune fille aux lèvres violettes,
Côte à côte rangés dans l’ombre au pied des ifs,
Livides, stupéfaits, immobiles, pensifs,
Spectres du même crime et des mêmes désastres,
De leur œil fixe et vide ils regardaient les astres.
Dès l’aube, on s’en venait chercher dans ce gazon
L’absent qui n’était pas rentré dans la maison ;
Le peuple contemplait ces têtes effarées ;
La nuit, qui de décembre abrège les soirées,
Pudique, les couvrait du moins de son linceul.
Le soir, le vieux gardien des tombes, resté seul,
Hâtait le pas parmi les pierres sépulcrales,
Frémissant d’entrevoir toutes ces faces pâles ;
Et, tandis qu’on pleurait dans les maisons en deuil,
L’âpre bise soufflait sur ces fronts sans cercueil,
L’ombre froide emplissait l’enclos aux murs funèbres.
O morts, que disiez-vous à Dieu dans ces ténèbres ?
On eût dit, en voyant ces morts mystérieux
Le cou hors de la terre et le regard aux cieux
Que, dans le cimetière où le cyprès frissonne,
Entendant le clairon du jugement qui sonne,
Tous ces assassinés s’éveillaient brusquement,
Qu’ils voyaient, Bonaparte, au seuil du firmament
Amener devant Dieu ton âme horrible et fausse,
Et que, pour témoigner, ils sortaient de leur fosse.
Montmartre ! enclos fatal ! quand vient le soir obscur,
Aujourd’hui le passant évite encor ce mur.
VI
Un mois après, cet homme allait à Notre-Dame.
Il entra le front haut ; la myrrhe et le cinname
Brûlaient ; les tours vibraient sous le bourdon sonnant ;
L’archevêque était là, de gloire rayonnant ;
Sa chape avait été taillée en un suaire ;
Sur une croix dressée au fond du sanctuaire
Jésus avait été cloué pour qu’il restât.
Cet infâme apportait à Dieu son attentat.
Comme un loup qui se lèche après qu’il vient de mordre,
Caressant sa moustache, il dit : — J’ai sauvé l’ordre !
Anges, recevez-moi dans votre légion !
J’ai sauvé la famille et la religion ! —
Et dans son œil féroce, où Satan se contemple,
On vit luire une larme… — O colonnes du temple,
Abîmes qu’à Patmos vit s’entr’ouvrir saint-Jean,
Cieux qui vîtes Néron, soleil qui vis Séjan,
Vents qui jadis meniez Tibère vers Caprée
Et poussiez sur les flots sa galère dorée,
O souffles de l’aurore et du septentrion,
Dites si l’assassin dépasse l’histrion !
VII
Toi qui bats de ton flux fidèle
La roche où j’ai ployé mon aile,
Vaincu, mais non pas abattu,
Gouffre où l’air joue, où l’esquif sombre,
Pourquoi me parles-tu dans l’ombre ?
O sombre mer, que me veux-tu ?
Tu n’y peux rien ! Ronge tes digues,
Epands l’onde que tu prodigues,
Laisse-moi souffrir et rêver ;
Toutes les eaux de ton abîme,
Hélas ! passeraient sur ce crime,
O vaste mer, sans le laver !
Je comprends, tu veux m’en distraire ;
Tu me dis : — Calme-toi, mon frère,
Calme-toi, penseur orageux ! —
Mais toi-même alors, mer profonde,
Calme ton flot puissant qui gronde,
Toujours amer, jamais fangeux !
Tu crois en ton pouvoir suprême,
Toi qu’on admire, toi qu’on aime,
Toi qui ressembles au destin,
Toi que les cieux ont azurée,
Toi qui dans ton onde sacrée
Laves l’étoile du matin !
Tu me dis : — Viens, contemple, oublie ! —
Tu me montres le mât qui plie,
Les blocs verdis, les caps croulants,
L’écume au loin dans les décombres,
S’abattant sur les rochers sombres
Comme une troupe d’oiseaux blancs,
La pêcheuse aux pieds nus qui chante,
L’eau bleue où fuit la nef penchante,
Le marin, rude laboureur,
Les hautes vagues en démence ;
Tu me montres ta grâce immense
Mêlée à ton immense horreur ;
Tu me dis : — Donne-moi ton âme ;
Proscrit, éteins en moi ta flamme ;
Marcheur, jette aux flots ton bâton ;
Tourne vers moi ta vue ingrate. —
Tu me dis : — J’endormais Socrate ! —
Tu me dis : — J’ai calmé Caton !
Non ! respecte l’âpre pensée,
L’âme du juste courroucée,
L’esprit qui songe aux noirs forfaits !
Parle aux vieux rochers, tes conquêtes,
Et laisse en repos mes tempêtes !
D’ailleurs, mer sombre, je te hais !
O mer ! n’est-ce pas toi, servante,
Qui traînes sur ton eau mouvante,
Parmi les vents et les écueils,
Vers Cayenne aux fosses profondes,
Ces noirs pontons qui sur tes ondes
Passent comme de grands cercueils !
N’est-ce pas toi qui les emportes
Vers le sépulcre ouvrant ses portes,
Tous nos martyrs au front serein,
Dans la cale où manque la paille,
Où les canons pleins de mitraille,
Béants, passent leur cou d’airain !
Et s’ils pleurent, si les tortures
Font fléchir ces hautes natures,
N’est-ce pas toi, gouffre exécré,
Qui te mêles à leur supplice,
Et qui, de ta rumeur complice,
Couvres leur cri désespéré !
VIII
Voilà ce qu’on a vu ! l’histoire le raconte,
Et, lorsqu’elle a fini, pleure, rouge de honte.
Quand se réveillera la grande nation,
Quand viendra le moment de l’expiation,
Glaive des jours sanglants, oh ! ne sors pas de l’ombre !
Non ! non ! il n’est pas vrai qu’en plus d’une âme sombre,
Pour châtier ce traître et cet homme de nuit,
A cette heure, ô douleur ! ta nécessité luit !
Souvenirs où l’esprit grave et pensif s’arrête,
Gendarmes, sabre nu, conduisant la charrette,
Roulements des tambours, peuple criant : frappons !
Foule encombrant les toits, les seuils, les quais, les ponts,
Grèves des temps passés, mornes places publiques
Où l’on entrevoyait des triangles obliques,
Oh ! ne revenez pas, lugubres visions !
Ciel ! nous allions en paix devant nous, nous faisions
Chacun notre travail dans le siècle où nous sommes,
Le poëte chantait l’œuvre immense des hommes,
La tribune parlait avec sa grande voix,
On brisait échafauds, trônes, carcans, pavois,
Chaque jour décroissaient la haine et la souffrance,
Le genre humain suivait le progrès saint, la France
Marchait devant, avec sa flamme sur le front ;
Ces hommes sont venus ! lui, ce vivant affront,
Lui, ce bandit qu’on lave avec l’huile du sacre !
Ils sont venus, portant le deuil et le massacre,
Le meurtre, les linceuls, le fer, le sang, le feu ;
Ils ont semé cela sur l’avenir, grand Dieu !
Et maintenant, pitié, voici que tu tressailles
A ces mots effrayants : vengeance ! représailles !
Et moi, proscrit qui saigne aux ronces des chemins,
Triste, je rêve et j’ai mon front dans mes deux mains,
Et je sens, par instants, d’une aile hérissée,
Dans les jours qui viendront s’enfoncer ma pensée.
Géante aux chastes yeux, à l’ardente action,
Que jamais on ne voie, ô Révolution,
Devant ton fier visage où la colère brille,
L’Humanité, tremblante et te criant : ma fille !
Et, couvrant de son corps même les scélérats,
Se traîner à tes pieds en se tordant les bras !
Ah ! tu respecteras cette douleur amère,
Et tu t’arrêteras, Vierge, devant la mère !
O travailleur robuste, ouvrier demi-nu,
Moissonneur envoyé par Dieu même, et venu
Pour faucher en un jour dix siècles de misère,
Sans peur, sans pitié, vrai, formidable et sincère,
Egal par la stature au colosse romain,
Toi qui vainquis l’Europe et qui pris dans ta main
Les rois, et les brisas les uns contre les autres,
Né pour clore les temps d’où sortirent les nôtres,
Toi qui par la terreur sauvas la liberté,
Toi qui portes ce nom sombre : Nécessité !
Dans l’Histoire où tu luis comme en une fournaise,
Reste seul à jamais, Titan quatrevingt-treize !
Rien d’aussi grand que toi ne viendrait après toi.
D’ailleurs, né d’un régime où dominait l’effroi,
Ton éducation sur ta tête affranchie
Pesait, et, malgré toi, fils de la monarchie,
Nourri d’enseignements et d’exemples mauvais,
Comme elle tu versas le sang ; tu ne savais
Que ce qu’elle t’avait appris, le mal, la peine,
La loi de mort mêlée avec la loi de haine ;
Et, jetant bas tyrans, parlements, rois, Capets,
Tu te levais contre eux et comme eux tu frappais.
Nous, grâce à toi, géant qui gagnas notre cause,
Fils de la liberté, nous savons autre chose.
Ce que la France veut pour toujours désormais,
C’est l’amour rayonnant sur ses calmes sommets,
La loi sainte du Christ, la fraternité pure.
Ce grand mot est écrit dans toute la nature :
Aimez-vous ! aimez-vous ! — Soyons frères ; ayons
L’œil fixé sur l’Idée, ange aux divins rayons.
L’Idée à qui tout cède et qui toujours éclaire,
Prouve sa sainteté même dans sa colère.
Elle laisse toujours les principes debout.
Etre vainqueurs, c’est peu, mais rester grands, c’est tout.
Quand nous tiendrons ce traître, abject, frissonnant, blême,
Affirmons le progrès dans le châtiment même.
La honte, et non la mort. — Peuples, couvrons d’oubli
L’affreux passé des rois, pour toujours aboli,
Supplices, couperets, billots, gibets, tortures !
Hâtons l’heure promise aux nations futures,
Où, calme et souriant aux bons, même aux ingrats,
La concorde, serrant les hommes dans ses bras,
Penchera sur nous tous sa tête vénérable !
Oh ! qu’il ne soit pas dit que, pour ce misérable,
Le monde en son chemin sublime a reculé !
Que Jésus et Voltaire auront en vain parlé !
Qu’il n’est pas vrai qu’après tant d’efforts et de peine,
Notre époque ait enfin sacré la vie humaine,
Hélas ! et qu’il suffit d’un moment indigné
Pour perdre le trésor par les siècles gagné !
On peut être sévère et de sang économe.
Oh ! qu’il ne soit pas dit qu’à cause de cet homme
La guillotine au noir panier, qu’avec dégoût
Février avait prise et jetée à l’égout,
S’est réveillée avec les bourreaux dans leurs bouges,
A ressaisi sa hache entre ses deux bras rouges,
Et, dressant son poteau dans les tombes scellé,
Sinistre, a reparu sous le ciel étoilé !
IX
Toi qu’aimait Juvénal gonflé de lave ardente,
Toi dont la clarté luit dans l’œil fixe de Dante,
Muse Indignation, viens, dressons maintenant,
Dressons sur cet empire heureux et rayonnant,
Et sur cette victoire au tonnerre échappée,
Assez de piloris pour faire une épopée !
Jersey, novembre 1852.
Victor Hugo, Les Châtiments
Les illustrations
Le pdf
Le pdf du poème Nox de Victor Hugo et du recueil Les Châtiments seront bientôt disponible.